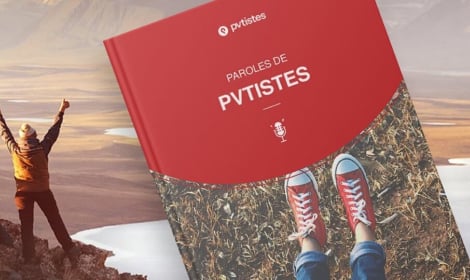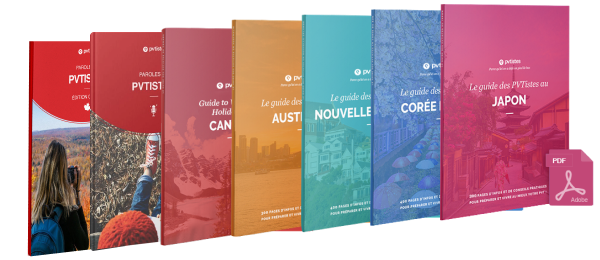Saviez-vous que l’origami, cet art du pliage japonais, est encore très présent dans la culture japonaise, et que tous les enfants apprennent à en confectionner à l’école ? Le plus courant est celui de la grue : un oiseau en papier, symbole de paix et de guérison. La tradition veut que, si un enfant tombe gravement malade, ses camarades lui en confectionnent un grand nombre. Une légende prétend que si l’enfant obtient mille grues, il sera guéri.
Savez-vous ce que veulent dire bonenkai, dogeza, hanko ou yakuza ?
Parce qu’au Japon, beaucoup de choses diffèrent de chez nous, nous nous sommes amusées à vous faire une petite liste de choses surprenantes, utiles ou typiquement japonaises, de A à Z. C’est parti pour l’abécédaire du Japon traditionnel !
 NKO
NKO
L’anko est une pâte sucrée de haricots rouges, d’origine chinoise, que l’on trouve très souvent dans les pâtisseries et les viennoiseries japonaises, notamment dans :
- L’anpan, une sorte de brioche fourrée à l’anko. L’anpan a donné naissance au héros Anpanman, qui a une tête en forme d’anpan et qui est très populaire chez les petits Japonais.
- Le daifuku, un mochi fourré. Qu’on trouve très souvent garnis à l’anko.
- Le taiyaki, un petit poisson fait de pâte à gaufre garni d’anko.
 ONENKAI
ONENKAI
Voici une célébration attendue avec impatience, ou redoutée selon votre degré de tolérance à l’alcool. Durant le mois de décembre, avant les cérémonies du Nouvel An, collègues et amis se retrouvent dans des restaurants ou des izakaya (pubs japonais) pour boire des quantités phénoménales d’alcool afin d’oublier ensemble l’année écoulée. Cette tradition, qui date du 15e siècle, est toujours bien vivante aujourd’hui.
Le bonenkai d’entreprise est généralement aux frais du patron, tandis que pour celui entre amis, on se cotise. Les débordements sont fréquents, et tout comportement sera toléré sous l’emprise de l’alcool puis oublié de tous le lendemain. Ainsi, plus qu’à l’habitude, vous verrez des hommes d’affaires titubant ou dormant dans la rue à l’approche du Nouvel An. Si vous êtes invité à un bonenkai, vous pouvez être assuré de passer une soirée animée et largement arrosée !
 OMPTER
OMPTER
En français, on a une seule et même façon de compter. En japonais, le système est bien différent : la façon de compter dépend de la nature ou de la forme des objets.
Par exemple, on comptera d’une certaine façon les choses longues et fines (cheveux, crayons, rues), d’une autre les choses plates (timbres, draps), les choses très petites (dés, trombones), les objets technologiques (voiture, TV), les vêtements (excepté ceux portés aux pieds), les tranches (pain, jambon, gâteaux), les bâtiments (immeubles, maisons), les étages, les personnes, les animaux (sauf oiseaux et lapins).
Pour compter des personnes, « un » se dira « hitori » et deux « futari ». Pour compter des objets ronds, « un » se dira « ikko » et deux « nikko ». Bref, un vrai casse-tête !
Heureusement, il existe aussi une façon générique de compter lorsqu’on ne connaît pas le compteur spécifique. Ce système est rarement utilisé par les adultes, mais plutôt par les enfants qui apprennent le japonais. Mais cela reste très bien pour commencer l’apprentissage de la langue.
Pour plus d’informations à ce sujet, retrouvez l’article Compter en japonais de Wikipedia.
 ARUMA
ARUMA
Le Daruma est une figurine ronde en papier mâché qui représente un moine bouddhiste : le moine Bodhidharma (Daruma en japonais). Cette petite (ou grande) figurine est utilisée pour faire des vœux.
Elle est souvent rouge, mais il en existe d’autres couleurs. Elle n’a ni bras, ni jambes, et ses yeux sont représentés par deux grands ronds blancs vides.
Pour faire un voeu avec un Daruma, il faut dessiner la pupille d’un des deux yeux en faisant un rond noir dans le cercle blanc. Puis, il faut poser la figurine en évidence quelque part chez soi et attendre – ou plutôt œuvrer à la réalisation de son souhait. En effet, le Daruma est là pour se rappeler de ses objectifs et essayer de les atteindre. Si le voeu se réalise, il faut alors dessiner la deuxième pupille sur l’oeil resté blanc.
Il est de coutume d’aller brûler le Daruma au temple où on l’a acheté au bout d’un an (période de “validité” d’un Daruma). Les Daruma ne s’accumulent pas, vous ne pouvez en avoir qu’un seul en usage à la fois.
Les Daruma peuvent s’acheter dans les temples ou dans les magasins de souvenirs. Plus qu’un objet spirituel, le Daruma est désormais un symbole du Japon traditionnel. C’est pour ça qu’on en voit à de nombreux endroits : en dessin, en images, etc.
 DO
DO
Edo est l’ancien nom de Tokyo, qui devient capitale du Japon vers 1600, sous le règne des Tokugawa. Aujourd’hui encore, ce nom est souvent utilisé pour parler du Tokyo d’antan. D’ailleurs, le musée consacré à la ville s’appelle « le Musée Edo-Tokyo » (station Ryogoku).
C’est aussi le nom d’une période historique, la période Edo, qui s’étend de 1600 à 1870, probablement l’une des plus connues de l’histoire japonaise chez nous. De nombreuses formes d’art se popularisent à cette époque, telles que les estampes ou le théâtre kabuki, et la classe des samouraïs est à son apogée.
Edo est aussi synonyme de catastrophes naturelles meurtrières, comme l’incendie d’Edo de 1657 (100 000 morts) ou l’éruption du Mont Fuji de 1707, la dernière éruption en date de la montagne la plus sacrée du Japon qui causa de nombreuses morts indirectes, notamment par la famine qui s’ensuivit.
 LEURS DE CERISIER
LEURS DE CERISIER
Comment ne pas parler des sakura, les fleurs de cerisier, lorsqu’on parle du Japon ? Symbole du pays, elles sont aujourd’hui indissociables du Japon dans l’esprit collectif. Leur floraison, aussi éclatante que rapide, représente le sens esthétique japonais : fragile et éphémère.
Cela fait longtemps que les Nippons se donnent rendez-vous sous les cerisiers au printemps pour pique-niquer en profitant de ce beau spectacle que leur offre la nature. La tradition du hanami (contemplation des fleurs) remonte à la période Nara (710-790).
La floraison est un événement extrêmement attendu dans l’archipel, on en parle aux informations tous les jours à l’approche du printemps et il existe même des bulletins météo spéciaux pour vous indiquer l’état de la floraison région par région. Les premiers cerisiers éclosent à Okinawa en mars et les derniers à Hokkaido au mois de mai.
Les Japonais aiment tellement leur sakura qu’ils déclinent cette fleur sous toutes ses formes au printemps ; vous trouverez ainsi de nombreuses boissons à base de sakura, des pâtisseries, des produits de beauté, et le prénom Sakura est aujourd’hui très à la mode chez les petites filles.
 EISHA
EISHA
Tout le monde sait plus ou moins qui elles sont, mais beaucoup les méconnaissent. Emblèmes immuables du Japon traditionnel, les geisha et les maiko (apprenties geisha) ont traversé les siècles et existent toujours aujourd’hui, bien que le métier soit en voie de disparition. Souvent prises pour des prostituées de luxe, elles n’en sont rien.
Ce sont des artistes accomplies que de riches clients paient pour les distraire lors de banquets. Elles chantent, jouent de leurs instruments traditionnels, servent à boire et font la conversation à leurs hôtes. Aucun contact physique n’est permis et elles ne sont pas non plus autorisées à entretenir des liaisons amoureuses.
Leur formation, longue et exigeante, dure des années avant qu’elles n’accèdent au statut très prisé de geisha, et leurs tarifs sont exorbitants. Autrefois au service de ministres, de samouraïs et de grands seigneurs, elles ont aujourd’hui pour clients de riches hommes d’affaires qui veulent impressionner leurs clients et quelques touristes fortunés. Vous les trouverez dans quelques quartiers traditionnels tels que Gion à Kyoto ou Asakusa, Akasaka et Shimbashi à Tokyo.
Métier extrêmement exigeant, peu rémunérateur et laissant peu de place à une vie privée, il est aujourd’hui boudé par les jeunes filles, qui aspirent à bien plus de liberté que ne peut leur offrir ce mode de vie si strict et hors du temps.
 ANKO
ANKO
En France, notre signature manuscrite nous sert à valider tous les documents importants. Au Japon, elle est quasi inexistante. Chaque Japonais possède son propre hanko, son sceau unique portant son nom de famille. Il est commandé à un artisan, qui le grave dans un matériau dur, et lui confère, par sa réalisation manuelle, un caractère unique.
Les hanko peuvent également être faits en quelques minutes via des machines, dans de nombreux magasins.
Le jitsu in est la forme la plus prestigieuse du hanko. Avec la particularité de posséder une encre rouge, il est utilisé pour toutes les formes de validation d’actes très importants, tels que la signature d’un contrat de propriété. Bien que tous les Japonais possèdent leur propre hanko, il n’est pas vraiment nécessaire pour un étranger d’en avoir un, notre signature étant reconnue à la place.
 IE : dire non
IE : dire non
Décliner une proposition en ayant recours au « non » direct est très malpoli. Ainsi, pour répondre par la négative, on dira plutôt « sumimasen », « chotto… » ou « muzukashii » (désolé, c’est difficile, etc.).
Le terme direct « iie », à savoir « non », sera utilisé pour refuser poliment un compliment, par modestie.
 OUYOU KANJI
OUYOU KANJI
Souvent le cauchemar des étudiants de langue japonaise, le jōyō kanji est la liste officielle des idéogrammes chinois utilisés dans l’écriture japonaise (kanji).
Mise à jour en 2010, la liste compte aujourd’hui 2 136 kanji que tous les écoliers apprennent au cours de leur scolarité et qu’il est nécessaire de connaître pour lire des documents de la vie courante (journaux, magazines, livres…).
À lire : Nos conseils pour apprendre le japonais !
Vous avez bien lu, il vous faudra connaître ces 2 136 kanji les plus courants (il en existe bien plus, les dictionnaires en répertorient 5 000 environ) pour vous débrouiller dans la vie quotidienne à l’écrit au Japon. Cette liste a été créée en 1923 et a été révisée cinq fois depuis.
Bon courage !
 IMONO
IMONO
Le kimono est le vêtement traditionnel japonais. C’est une longue robe en forme de T, avec de larges manches. Il est accompagné d’une large ceinture nouée dans le dos, appelée obi.
Les kimonos existent en plusieurs couleurs et matières et sont aujourd’hui portés principalement lors d’événements bien particuliers.
Un véritable kimono est un vêtement de très grande qualité qui peut coûter très cher.
Si le kimono est de moins en moins porté au quotidien, le yukata, sa version plus légère et plus décontractée, est quant à lui toujours bien présent. Les yukata sont similaires aux kimonos dans leur forme mais sont initialement utilisés en sortie de bain. Aujourd’hui, les Japonais les portent même à d’autres occasions.
Dans la grande majorité des hôtels du pays, des yukata sont mis à disposition au même titre que les serviettes de bain et les chaussons.
 AQUE
AQUE
Longtemps considéré comme un artisanat d’origine chinoise, de récentes recherches ont démontré que l’art de la laque serait d’origine japonaise, puisque des vestiges plus anciens ont été découverts à Hokkaido. Les Japonais se sont longtemps distingués dans cet artisanat et, aujourd’hui, certaines régions orientent leur tourisme vers cette activité (Kyoto, Fukushima ou Iwate). La laque se retrouve sur des objets précieux et distingués, qui font d’excellents souvenirs à rapporter à des amis japonais.
 ATSURI
ATSURI
Les matsuri sont des festivals traditionnels que l’on retrouve partout dans le pays. Chaque ville, chaque village, et même chaque quartier dans les grandes villes a son matsuri.
C’est en été qu’il y en a le plus, mais on peut en trouver tout au long de l’année.
Lors de ces matsuri, il y a souvent des processions, ou des parades (le matsuri peut avoir un caractère religieux ou non), ainsi que des stands de nourriture et de boissons. C’est l’occasion parfaite pour les Japonais de se réunir et de passer un bon moment ensemble. Et pour les étrangers, de passage ou non, c’est un bon moyen de découvrir et de profiter de la culture japonaise.
Sur le site de l’office du tourisme de Tokyo, vous pouvez retrouver la liste des matsuri de la ville.
 OMIJI
OMIJI
Le printemps à les sakura, l’automne, les momiji !
Les momiji sont les érables japonais dont les feuilles deviennent rouges, orange à l’automne, offrant ainsi un magnifique paysage.
À l’inverse des sakura, les momiji changent de couleur d’abord dans le nord du Japon, à Hokkaido, entre fin septembre et début octobre, puis dans le centre et le sud du pays, plutôt vers mi-novembre, début décembre.
Si les sakura sont les plus populaires à l’international, les momiji n’ont rien à leur envier. Dans les deux cas, ces phénomènes naturels sont très beaux à observer et méritent qu’on y porte attention.
 IKKA
IKKA
Si vous êtes amateur de whisky, alors ce nom vous dit sans doute quelque chose.
En effet, les Japonais ont découvert cet alcool venu d’ailleurs en 1853 lorsque le commodore Perry a forcé le Japon à s’ouvrir à l’étranger, en emportant quelques bouteilles comme cadeaux diplomatiques. Depuis, le pays est devenu l’un des leaders internationaux et son whisky tient souvent la première place au classement mondial.
C’est Masataka Taketsuru (pourtant issu d’une famille de producteurs de sake, un alcool de riz), envoyé en Écosse au début du siècle pour se former, qui créera la distillerie Nikka bien des années plus tard, une fois revenu au Japon avec une Écossaise au bras comme épouse. Leur histoire est d’ailleurs l’objet d’un drama (série japonaise) récent, Massan.
Si vous voulez ramener un cadeau du Japon à vos proches en France, le whisky est définitivement un choix de connaisseur.
 JIGI
JIGI
Ce terme désigne le fait de se courber pour saluer, remercier ou encore s’excuser. Le contact physique étant peu apprécié des Japonais, la pratique des ojigi est très courante, même si, dans les affaires, la poignée de main est aussi usitée. Chez nous, le fait de s’incliner devant quelqu’un pourrait être associé à une forme de soumission ou d’humiliation. Mais au Japon, l’ojigi exprime le respect à l’égard de la personne saluée et c’est un geste à la fois important et naturel.
L’inclinaison en avant est plus ou moins prononcée selon la personne que l’on salue. Elle sera, par exemple, légère pour un membre de la famille, et plus marquée s’il s’agit de saluer un client.
Dans le domaine professionnel, pour s’excuser face à un supérieur ou un client, on s’incline les bras tendus le long du corps en disant « moshiwake gozaimasen ». Le temps d’inclinaison dépendra de l’importance de l’erreur commise et du statut de la personne offensée.
 MIYAGE
MIYAGE
Au retour d’un voyage, il est de coutume de ramener des omiyage : des souvenirs de voyage, à sa famille et à ses collègues. Il s’agit souvent de spécialités culinaires de la région visitée et joliment emballées. Il serait malvenu d’oublier ce cadeau une fois rentré de vacances.
Dans toutes les gares et les aéroports du Japon, on trouve des magasins où l’on peut acheter des omiyage.
 URESENTO
URESENTO
Qui signifie « cadeau » en japonais (reconnaissez le mot anglais present, massacré à coups de katakana !).
En plus des cadeaux qu’il convient d’offrir lorsqu’on est invité chez un Japonais, au moment de la Saint-Valentin ou encore pour un anniversaire, il existe deux périodes de cadeaux par an, pendant lesquelles les Japonais offrent un cadeau à leur supérieur hiérarchique. La première période, en novembre/décembre, s’appelle o-seibo. La seconde, qui a lieu en juin/juillet, s’appelle o-chūgen. Le prix n’est généralement pas retiré du cadeau. C’est à la personne de choisir la gamme de prix qui correspond à la situation (selon l’importance du supérieur). Il ne faut ni le gêner avec un cadeau trop onéreux, ni l’insulter avec un cadeau trop modeste.
Le cadeau sera offert à deux mains. Si vous recevez un cadeau, faites-le également à deux mains, en vous inclinant légèrement et en remerciant la personne qui vous l’offre. Il convient de ne pas ouvrir son cadeau devant celui qui vous l’offre, sauf occasion particulière. Lorsqu’on reçoit un cadeau, il est de bon ton d’offrir par la suite un cadeau en retour, plus ou moins égal à la moitié de la valeur du présent reçu.
Celui qui offre un cadeau tentera généralement de s’excuser de la petite valeur de celui-ci, quelle qu’elle soit. La bienséance veut qu’il minimise l’importance du présent.
 UATRE
UATRE
La peur du chiffre 4 est très répandue en Asie, et tout particulièrement au Japon. Ce phénomène a son propre terme : la « tétraphobie ». Cette peur existe depuis très longtemps et est encore grandement présente aujourd’hui. Ainsi, de nombreux immeubles n’ont pas de 4e étage, on évite ce numéro lorsque l’on choisit son numéro de téléphone, et les nombres comportant ce chiffre (14, 24…) sont eux aussi évités.
Pourquoi les Japonais ont-ils peur de ce chiffre ? Tout simplement car la prononciation du chiffre 4 est la même que celle du mot « mort » (shi dans les deux cas). Voilà pourquoi il y a deux prononciations possibles pour ce chiffre : shi (qu’on évite au maximum) et yon / yo qu’on préfère utiliser à la place. Dans le même registre, le chiffre 7 comporte aussi le mot mort, shichi ; il a donc, lui aussi, une autre prononciation possible, nana.
 EIWA
EIWA
Au Japon, on divise les époques en ères. Chaque ère correspond au règne d’un empereur. Quand l’empereur change, l’ère aussi change.
L’empereur actuel est Naruhito. Il a succédé à l’empereur Akihito en 2019. Le Japon est alors passé de l’ère Heisei à l’ère Reiwa.
Cette information n’est pas simplement anecdotique. Il est nécessaire de connaître les différentes ères pour pouvoir indiquer une date, notamment sa date de naissance.
On vous donne plus de détails dans l’article Se repérer dans le temps au Japon : les ères japonaises
 YOKAN
YOKAN
Le ryokan est une auberge typiquement japonaise. La demeure et son intérieur sont entièrement de style japonais. Il en existe plusieurs dizaines de milliers dans tout le pays à des prix plus ou moins élevés.
Si vous souhaitez vivre une expérience 100 % japonaise, c’est dans un ryokan que vous devez vous rendre.
À lire : Trouver un logement au Japon : informations et conseils pratiques
 ENTO
ENTO
Ces bains publics des villes, dérivés du onsen, ne sont pas des bains pour se laver, mais pour se détendre, se réchauffer et partager un moment privilégié avec ses amis, sa famille ou ses voisins. Les bains pour hommes sont séparés des bains pour femmes. En passant la porte d’un sento, on se dirige vers les vestiaires où l’on se déshabille complètement. C’est intégralement nu qu’on doit se rendre vers la salle des bains, une salle carrelée du sol au plafond.
À lire : Onsen : mode d’emploi pour éviter les faux pas
Certains sento possèdent plusieurs salles de bains, et il y a souvent un sauna à disposition, ainsi qu’un bain froid. Avant d’entrer dans le bain pur et clair, il est obligatoire de se laver le corps et les cheveux, dans les rangées de douches prévues à cet effet.
 HINIGAMI
HINIGAMI
Les shinigami sont les dieux de la mort dans la culture japonaise. Ils sont l’équivalent de notre Faucheuse.
Les shinigami sont très présents dans la culture japonaise et sont très souvent représentés dans les œuvres culturelles, notamment les mangas et les animés.
Parmi les œuvres modernes les plus populaires on peut citer le classique Death Note de Tsugumi Ōba. Un jeune lycéen se retrouve soudainement en possession du cahier de la mort d’un shinigami. Grâce à ce carnet, il peut décider de la mort de qui il veut en inscrivant simplement le nom de cette personne sur ledit carnet. Tout au long du manga (et de l’animé), le jeune lycéen sera accompagné par le shinigami Ryūk, propriétaire initial du carnet, que lui seul peut voir.
On peut également citer Bleach de Tite Kubo, où l’on suit les aventures de shinigami représentés comme des samouraïs, dont le rôle est de protéger les mortels des démons et d’emmener leurs âmes dans l’au-delà.
Selon les œuvres, les shinigami ont des apparences et des rôles qui peuvent être très variés.
 ATEMAE
ATEMAE
Le tatemae est un concept très important au Japon. Il désigne l’obligation sociale qui établit la pensée « unique » de la société et, ainsi, le comportement adéquat en public. Il peut être associé à un certain manque de franchise, mais il ne reflète en réalité qu’un comportement adapté en société. Ce serait donc une erreur de penser que le tatemae est une forme d’hypocrisie. C’est en fait une manière d’être et d’agir avec les autres pour éviter tout conflit.
Un proverbe japonais dit : « Si un clou sort de la planche, il faut l’enfoncer avec un couteau ». En société, au Japon, on évite donc d’insister sur ses honne, ses véritables sentiments, et on préférera acquiescer ou même soutenir certaines décisions prises dans un groupe, même si l’on s’y oppose intérieurement. C’est une façon de préserver l’harmonie dans le groupe.
 ORII
ORII
Les torii sont des portails japonais de couleur vermillon (entre le rouge et l’orange). C’est un symbole très connu du Japon que l’on retrouve dans tout le pays.
Les torii sont des portails qui marquent l’entrée dans une enceinte sacrée. On en trouve à l’entrée des sanctuaires shintoïstes.
À lire : Temples bouddhistes et sanctuaires shintō au Japon
Les torii marquent une séparation entre le monde humain et le monde des dieux. Le torii doit donc être traversé deux fois : une fois pour entrer dans le monde spirituel et une autre pour en sortir. Il est de coutume également de s’incliner – de faire un ojigi – à son passage. Il faut s’incliner face au sanctuaire, même lors de sa sortie. Vous pourrez observer les Japonais se retourner au moment de sortir du temple, à leur passage sous le torii, afin de bien s’incliner face au sanctuaire.
Dans le célèbre sanctuaire Fushimi Inari-taisha de Kyoto, vous pouvez faire une promenade de plusieurs kilomètres dans l’enceinte du site, entièrement bordée de torii. Il y en a des milliers. Ces torii sont des offrandes faites au sanctuaire.
 ME
ME
L’autre star du printemps, le prunier, annonce la floraison du cerisier puisqu’il s’ouvre quelques jours avant lui. Tout aussi beau, mais moins célèbre aujourd’hui, c’est lui qu’on admirait pourtant autrefois, avant de s’enticher des sakura à partir de la période Heian (vers 795).
Il reste un spectacle agréable à regarder avec ses fleurs d’un rose profond et son fruit, la prune, est utilisé dans diverses recettes. Tout d’abord, l’umeboshi, une prune macérée dans du sel à la saveur particulière, est un ingrédient phare des onigiri, les boules de riz japonaises similaires à nos sandwiches.
Il y a aussi l’umeshu, le vin de prune, un alcool léger très prisé des femmes, qui peut se boire avec des glaçons, du soda ou de l’eau chaude en hiver ! De nombreuses familles fabriquent elles-mêmes leur alcool maison, les ingrédients étant faciles à trouver et à des prix raisonnables.
 AGUE DE KANAGAWA
AGUE DE KANAGAWA
Vous avez très certainement déjà vu cette célèbre vague ou l’une de ses représentations.
La Grande Vague de Kanagawa est une estampe du peintre Katsushika Hokusai datant du XIXe siècle. L’estampe représente une grande vague en mouvement en premier plan avec une vue du mont Fuji en second plan.
La Vague de Kanagawa a été énormément reprise et diffusée, en faisant aujourd’hui un symbole du Japon. On la retrouve notamment sur les nouveaux billets de 1000 yens.
 AKAME
AKAME
Au Japon, manger des algues séchées fait partie de l’alimentation quotidienne. Il en existe plusieurs sortes, mais les plus connues sont le wakame et le nori.
Elles se présentent sous différentes formes (en plaques bien lisses ou en branches) et sont utilisées dans de nombreux plats : on en trouve dans la soupe miso, ou emballant les makizushi, les sushis enroulés dans une feuille verte noirâtre (si vous ne le saviez pas, c’est de l’algue séchée), elles sont parfois mangées telles quelles, en plaques lisses, pour grignoter. Riches en minéraux, elles sont excellentes sur le plan nutritionnel et font partie du secret de longévité des habitant de l’île du Sud, étant une composante essentielle du régime d’Okinawa.
![]()
Malgré tous nos efforts, nous n’avons rien pu trouver pour la lettre X. Nous laissons donc ce paragraphe ouvert à vos suggestions ! Donnez-nous vos idées avec un mot commençant par X, en français ou en japonais.
 AKUZA
AKUZA
Mis au ban de la société, mais faisant partie intégrante de la culture japonaise, la mafia qui se veut descendante directe des samouraïs est l’une des plus puissantes et des plus riches au monde, malgré un très net déclin depuis le début des années 2000. Yakuza est le terme générique pour désigner les membres de la mafia japonaise et plus généralement la mafia japonaise, mais il existe plusieurs groupes de yakuza, parfois rivaux, et plus ou moins puissants.
Les yakuza sont reconnaissables à leurs tatouages (c’est de moins en moins vrai, cependant) et parfois à leurs phalanges coupées (manière de présenter ses “excuses” au chef du clan en cas de faute, le yubitsume). Ils trempent dans beaucoup d’affaires : commerce, racket, prostitution et politique.
L’interdiction d’accès omniprésente aux personnes tatouées dans de nombreux lieux publics (piscines, sento, plages…) est due aux yakuza, que l’on veut chasser et ne surtout pas mélanger aux « bonnes gens ». Pourtant, dès qu’ils en ont l’occasion, les yakuza aiment se montrer en héros aux yeux du grand public, comme lors des tremblements de terre où ils sont souvent parmi les premiers à venir porter secours à la population, les clans mettant leurs hommes et moyens de transport au service des recherches.
Il existe initialement trois grandes familles yakuza, la plus puissante d’entre elles étant la Yamaguchi-gumi, qui s’est divisée en deux en 2015, donnant naissance à un nouveau clan. Cette scission a créé de nombreux incidents et règlements de compte en pleine rue, chose assez inhabituelle au Japon. Par la suite d’autres scissions ont eu lieu. En plus des grandes familles qui comptent dans leurs rangs la grande majorité des yakuza du pays, il existe des clans “plus petits” avec des influences plus localisées.
Aujourd’hui, les familles yakuza s’orientent de plus en plus vers des affaires « propres », en possédant des bureaux avec pignon sur rue.
 AZEN
AZEN
Le zazen (méditation assise basée sur les principes zen du bouddhisme) est encore aujourd’hui présent dans la culture japonaise. Basée essentiellement sur la respiration et le compte de 1 à 100, cette pratique a toujours aidé les Japonais à prendre du recul sur leur vie et à faire le vide dans leur esprit tourmenté. Récemment, elle semble en plein essor, côte à côte avec le yoga, dans cette société toujours plus stressée et déconnectée de la nature et de l’humain.
De nombreux dōjō (salles de méditation) ouvrent leurs portes à tous, débutants ou confirmés, et il existe même à Tokyo des séances de découverte en anglais pour les étrangers souhaitant s’ouvrir au spiritualisme nippon. Vous pouvez également faire des séjours dans des dōjō ou temples où en plus de participer à la méditation quotidienne des prêtres, vous prendrez part à toutes les activités de la communauté (ménage, cuisine, préparation des chambres), pour une expérience inédite et dépaysante. Sans aller s’isoler dans les montagnes, vous pouvez trouver des dōjō et des temples accueillant les étrangers aux portes des grandes villes, comme à Saitama, dans la banlieue de Tokyo.