Découvrez le parcours fascinant d'Alexis Auger, un jeune sociologue franco-québécois, qui plonge dans les dynamiques migratoires des jeunes Français au Québec. À travers son mémoire, il explore le passage de l'expatriation temporaire à l'établissement permanent, un sujet peu couvert malgré la présence notable de plus de 100 000 Français au Québec. Alexis, témoin et acteur de ces transitions, utilise son propre vécu pour questionner et comprendre les raisons profondes qui poussent les expatriés à faire du Québec leur maison. Son travail révèle des insights sur l'intégration, l'appartenance et les trajectoires migratoires variées, enrichi par des témoignages de Français aux parcours hétérogènes. Curieux d'en savoir plus sur ces histoires de vie qui naviguent entre culture, identité et appartenance? Plongez dans l'article complet pour une immersion dans le monde complexe de l'immigration franco-québécoise.
pvtistes
Bonjour Alexis, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Alexis Auger, j’ai 26 ans et je complète ma maîtrise en sociologie à l’Université de Montréal. J’ai fait un bac à l’UQAM, j’ai fait un échange étudiant en France, à Sciences Po Lille, d’où vient ma mère. Je suis également professeur au Cégep du Vieux Montréal, au département de sociologie.
pvtistes
Tu finalises un mémoire intitulé « Carrières migratoires des jeunes Françaises et Français au Québec : de l’expatriation temporaire à l’établissement permanent ? ». Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
J’ai choisi ce sujet parce que je suis moi-même à moitié français (franco-québécois). J’ai eu à choisir entre les deux pays à l’âge de 15 ans suite à une garde partagée internationale atypique entre une mère française et un père québécois.
Lorsque je me suis intéressé au sujet, j’ai découvert qu’il y avait peu de littérature scientifique sur les Français au Québec, et plus particulièrement sur les jeunes. Surtout, il n’y avait presque rien sur les mobilités temporaires devenant des migrations plus permanentes, alors que je constatais cette transition autour de moi chez des gens en échange universitaire, en PVT, etc. Il y a plus de 100 000 Français immigrés au Québec et, finalement, on en parle assez peu par rapport à d’autres communautés. En bref, j’ai voulu étudier ce que j’appelle le passage du temporaire au permanent.
Lorsque je me suis intéressé au sujet, j’ai découvert qu’il y avait peu de littérature scientifique sur les Français au Québec, et plus particulièrement sur les jeunes. Surtout, il n’y avait presque rien sur les mobilités temporaires devenant des migrations plus permanentes, alors que je constatais cette transition autour de moi chez des gens en échange universitaire, en PVT, etc. Il y a plus de 100 000 Français immigrés au Québec et, finalement, on en parle assez peu par rapport à d’autres communautés. En bref, j’ai voulu étudier ce que j’appelle le passage du temporaire au permanent.
pvtistes
Peux-tu nous contextualiser l’immigration française au Québec ?
Il y a tout un contexte socio-historique autour de l’immigration française au Québec. Quand on se lance dans un sujet comme celui-ci, il faut d’abord savoir d’où on part. J’ai découvert qu’il y avait une histoire relationnelle vraiment particulière entre les Français et les Québécois qui remonte jusqu’à la période coloniale de la Nouvelle-France (1608-1763).
Le régime français s’est achevé assez brutalement par la Conquête britannique en 1760. Je ne veux pas faire de cours d’histoire, mais il faut mentionner que les quelque 100 000 Français du Canada de l’époque sont restés complètement coupés de la France jusqu’à la reprise des contacts dans la seconde moitié du 19e siècle. Les liens reprennent progressivement autour de 1850 et la société française a alors énormément changé, notamment après la Révolution française (1789) ayant aboli les privilèges de la noblesse et de l’Église. Les Français du Québec demeurent pour leur part dans une mentalité plus traditionnelle et rurale héritée de l’Ancien régime, où la religion catholique est très importante. Les premiers immigrants français, à cette époque, sont surtout des ecclésiastiques cherchant à retrouver cette société d’antan.
Dans mes recherches, j’ai constaté que le malaise relationnel existant entre les Français et les Québécois remonterait donc à la fin du 19e siècle ; ça ne date pas d’hier ! Des Français cultivés arrivaient au Québec pour imposer la bonne manière de parler, de penser, de travailler, alors que les Canadiens francophones avaient leur propre manière de vivre, malgré une langue et une religion commune. S’il y a bien une expression qui cristallise jusqu’à aujourd’hui cette ambiguïté, c’est le qualificatif de « maudits français », qui symbolise toute cette relation de proximité et de distance, de sympathie mêlée à de la méfiance. Je fais ici référence à de nombreuses recherches historiques, notamment celles de Jean-Pierre Dupuis (2005, 2012).
Aujourd’hui, les conditions de vie de la communauté française du Québec sont généralement assez favorables par rapport aux autres communautés issues de l’immigration, notamment sur les plans du logement ou du revenu. Ce qui est très particulier avec les Français au Québec, c’est le caractère assez révocable de cette immigration, l’idée d’un retour en France étant rarement exclue. Elle n’est souvent pas perçue comme une immigration mais plutôt comme une expatriation. C’est un mot qu’on utilise généralement pour des migrations entre les pays du Nord, comme si on n’avait pas le statut de migrant ou d’immigrant, notamment à cause des stigmates qui y sont souvent associés, alors que dans les faits, c’est la même chose : un déplacement durable dans un autre pays, ça demeure une migration.
Le régime français s’est achevé assez brutalement par la Conquête britannique en 1760. Je ne veux pas faire de cours d’histoire, mais il faut mentionner que les quelque 100 000 Français du Canada de l’époque sont restés complètement coupés de la France jusqu’à la reprise des contacts dans la seconde moitié du 19e siècle. Les liens reprennent progressivement autour de 1850 et la société française a alors énormément changé, notamment après la Révolution française (1789) ayant aboli les privilèges de la noblesse et de l’Église. Les Français du Québec demeurent pour leur part dans une mentalité plus traditionnelle et rurale héritée de l’Ancien régime, où la religion catholique est très importante. Les premiers immigrants français, à cette époque, sont surtout des ecclésiastiques cherchant à retrouver cette société d’antan.
Dans mes recherches, j’ai constaté que le malaise relationnel existant entre les Français et les Québécois remonterait donc à la fin du 19e siècle ; ça ne date pas d’hier ! Des Français cultivés arrivaient au Québec pour imposer la bonne manière de parler, de penser, de travailler, alors que les Canadiens francophones avaient leur propre manière de vivre, malgré une langue et une religion commune. S’il y a bien une expression qui cristallise jusqu’à aujourd’hui cette ambiguïté, c’est le qualificatif de « maudits français », qui symbolise toute cette relation de proximité et de distance, de sympathie mêlée à de la méfiance. Je fais ici référence à de nombreuses recherches historiques, notamment celles de Jean-Pierre Dupuis (2005, 2012).
Aujourd’hui, les conditions de vie de la communauté française du Québec sont généralement assez favorables par rapport aux autres communautés issues de l’immigration, notamment sur les plans du logement ou du revenu. Ce qui est très particulier avec les Français au Québec, c’est le caractère assez révocable de cette immigration, l’idée d’un retour en France étant rarement exclue. Elle n’est souvent pas perçue comme une immigration mais plutôt comme une expatriation. C’est un mot qu’on utilise généralement pour des migrations entre les pays du Nord, comme si on n’avait pas le statut de migrant ou d’immigrant, notamment à cause des stigmates qui y sont souvent associés, alors que dans les faits, c’est la même chose : un déplacement durable dans un autre pays, ça demeure une migration.
pvtistes
Avant de commencer ton travail de recherche et notamment tes entretiens, quelles étaient pour toi les raisons qui poussaient les expatriés à partir au Canada ?
J’avais comme hypothèse de travail que les Français étaient attirés par des perceptions favorables sur le Québec en amont de leur migration. Pour moi, la clé de l’interprétation était dans la rencontre avec tous ces mythes (réels ou imaginés) : l’eldorado canadien, « ils sont gentils, ce sont nos cousins », les cabanes à sucre, les igloos, les caribous, Céline Dion… Je pensais que les Français cherchaient à venir pour rencontrer ces mythes et voir ce qui était vrai ou non.


pvtistes
Finalement, suite à tes recherches, quelles sont ces raisons ?
J’ai interrogé un échantillon de 16 personnes ayant la nationalité française et arrivées au Québec depuis plus de 2 ans et avant l’âge de 30 ans, en essayant de diversifier l’échantillon au maximum : des personnes racisées, des blancs, des femmes, des hommes, résidents de Montréal, des régions, etc. J’ai essayé d’avoir une certaine représentation des strates de la population, même si ce n’est pas une étude statistiquement significative. Par contre, les récurrences dans ces récits de vie permettent de théoriser et de monter en généralité sur plusieurs plans.
Finalement, ces entretiens ont complément contredit mon hypothèse de départ. En effet, les raisons de partir, de quitter la France et de choisir le Canada ou le Québec ne sont pas du tout les mêmes. La décision, ensuite, de rester, de prolonger, est une autre étape. Enfin, le fait d’appartenir, de rester de manière permanente, c’en est encore une autre, alors qu’on pense généralement tout ça ensemble.
Je propose de détailler séparément ces 3 étapes distinctes :
Finalement, ces entretiens ont complément contredit mon hypothèse de départ. En effet, les raisons de partir, de quitter la France et de choisir le Canada ou le Québec ne sont pas du tout les mêmes. La décision, ensuite, de rester, de prolonger, est une autre étape. Enfin, le fait d’appartenir, de rester de manière permanente, c’en est encore une autre, alors qu’on pense généralement tout ça ensemble.
Je propose de détailler séparément ces 3 étapes distinctes :
- Partir : choisir de quitter la France et d’arriver à Montréal, au Québec, ça fait écho à quelque chose qui est important en sociologie de l’immigration : on parle de facteurs d’attractivité versus de répulsion. J’ai réalisé qu’il y en avait, mais peut-être moins que je pensais. Il y a des raisons, oui, de quitter la France, certaines ont été nommées, mais au moment du départ, pas nécessairement. On parle par exemple du contexte sociopolitique et économique parfois assez tendu, la montée de l’extrême droite, du système scolaire difficile, élitiste, on cherche parfois à contourner la sélectivité en France en venant au Canada. Plus généralement, ce n’est ni la France qui repousse ni le Canada qui attire, mais plutôt une volonté de voyage, de mobilité à l’étranger, des facteurs expérientiels ou stratégiques, de valoriser un CV, etc. On remarque un certain « capital de mobilité », soit un ensemble de prédispositions à entrer en migration.
- Rester : lorsqu’on arrive, il y a toujours les premiers contacts, les premiers chocs, l’appréciation, mais aussi les désillusions. Ce qui est récurrent dans les parcours, c’est un processus d’établissement assez diffus. C’est toujours le kilomètre supplémentaire, comme disait un participant. Quand on parle de rester, on ne parle pas encore d’appartenir de manière permanente. Rester, c’est plutôt « je suis là pour les 6 mois de mon échange étudiant, ou mon projet initial, c’est mon pvt de 1 ou 2 ans, puis finalement je trouve une nouvelle opportunité, je prolonge par un permis de travail, je travaille suffisamment pour obtenir la résidence permanente, je fais le tour du poteau, etc. ». Ce sont des événements très marquants dans les premiers mois et premières années. Le fait de rester au debut, c’est énormément de stimulation. C’est pour certains une émancipation, un développement personnel qu’on voit chez ces Français qui arrivent à Montréal et qui découvrent ou perçoivent la société québécoise comme un peu plus libérale, un peu plus tolérante, bienveillante, un certain civisme, une simplicité des interactions. Ce sont peut-être des clichés, mais ceux-ci sont relevés et vécus par les personnes interrogées.
Il est intéressant de voir que les difficultés peuvent révéler un ancrage : quand t’en es à ton 3e permis successif, que t’as pas de réponse pour ta résidence permanente, que t’en as marre de toutes ces démarches, tu peux réaliser que finalement, t’as pas envie de partir, que tu te bats pour rester. Parfois, c’est une réalisation qui apparaît sans qu’on en ait eu conscience avant. Le fait est qu’on veut rester. C’est aussi l’angle mort de mon mémoire : les personnes qui sont parties, je ne les ai pas interrogées. Je parle seulement des gens qui restent. - Appartenir : comment la mobilité devient une migration ? Pour moi, le pont entre les deux, cette fameuse envie de rester, ce sont toutes les dimensions de l’appartenance, de l’intégration. Il y a plusieurs dimensions de l’intégration, comme l’intégration structurelle : on parle de l’emploi, du salaire, le visa, des choses tangibles, objectives. Il y a aussi une dimension plus culturelle, relationnelle ou encore identitaire, comme l’appréciation de la culture, des relations amicales, conjugales et plus généralement le fait de se sentir québécois ou non, de se sentir davantage ou moins français. On insiste souvent sur les facteurs économiques et administratifs (les revenus, les visas et permis) mais ce qui est pour moi la condition, l’enjeu prioritaire pour rester, ce sont principalement toutes ces dimensions culturelles et relationnelles. On peut prendre comme exemple cette personne qui a un job moyen, mais qui a une conjointe québécoise, est entourée d’amis québécois et adore la culture québécoise. Lui, il s’en fout d’avoir une trajectoire déqualifiante au niveau de l’emploi : il se sent bien, il se sent intégré, « à la maison ». À l’inverse, j’ai vu le cas d’une personne avec de très bon revenus, un peu de difficultés au niveau permis de travail mais ça va, la résidence permanente devrait arriver, mais sans ancrage au niveau culturel et relationnel. Elle n’est entourée que d’expatriés français. Lors d’un projet familial ou d’un choc comme une rupture ou un mauvais épisode professionnel, cette personne dit pouvoir potentiellement retourner en France.

pvtistes
Peux-tu nous en dire plus sur les personnes que tu as interrogées ?
On parle souvent des « Français au Québec », on imagine une personne avec sa Canada Goose qui s’appelle Ludovic ou Ségolène, mais en fait, j’ai réalisé que les Français au Québec sont beaucoup plus hétérogènes. Il y a beaucoup de clivages. Ça a révélé d’ailleurs plein de choses sur les raisons de partir ou de rester.
Je pense notamment à la condition féminine et au sexisme. La totalité des participantes à la recherche ont exprimé qu’elles n’ont pas nécessairement quitté la France à cause du sexisme, ce n’était pas une raison de partir, mais c’est devenu une raison de rester. Ces femmes ont réalisé à quel point elles subissaient le harcèlement public, le sentiment d’insécurité, des inégalités dans différentes sphères de leurs vies et des enjeux de violences sexuelles. Loin de moi l’idée de conclure que le Québec est moins sexiste ou moins patriarcal, ce n’est pas mon rôle, mais plutôt d’amplifier la voix et l’expérience de ces participantes pour qui la migration a été le moment d’une prise de conscience féministe. Elles disent se sentir en sécurité au Québec, relèvent la possibilité de s’habiller comme elles le désirent, par exemple, sans se faire insulter dans la rue, et on voit alors que les logiques d’établissement ne sont pas les mêmes selon le genre.
Pour les conditions des personnes racisées, c’est plus nuancé. Il y a aussi un rejet du contexte politique français, de l’extrême-droite, du racisme ordinaire. Des participants parlent du fait qu’en France, on les traitait différemment ou faisaient l’expérience de micro-agressions au quotidien. Par contre, au Québec, ce n’est pas une expérience exempte de violence ou de difficultés pour les personnes racisées. Un participant m’a dit, par exemple, avoir découvert « le fait d’être noir » au Québec. En France, on se veut universaliste, on dit plutôt « mais non, t’exagères, le serveur ne t’a pas mal parlé parce que t’es black, on ne voit pas la couleur ». Finalement, c’est quelque chose qui est tellement récurrent dans leur vie, ils réalisent en venant ici qu’ils ont maintenant plus de mots pour en parler.
Ces personnes racisées, notamment d’origine africaine, antillaise ou asiatique, se sont senties enfin validées dans leur identité française… une fois qu’elles ne sont plus en France ! En France, on leur demande toujours « D’où tu viens ? », « Tes parents viennent d’où ? », « Est-ce que t’es né ici ? ». Au Québec, on va plutôt dire, « J’entends ton accent, d’où tu viens ? De la France ? Ok ». Des participants m’ont confié enfin se sentir français et fier de l’être en étant, paradoxalement, loin de la France. C’est une redécouverte de l’identité française.
Sur les enjeux LGBTQ+, moins de personnes de mon échantillon s’y identifiaient donc je ne peux pas généraliser, mais il y a des personnes qui ont dit avoir eu plus de facilités à se dire faire partie de la communauté LGBTQ+ ou de la communauté queer. Plusieurs ont constaté qu’au Québec, il y aurait une plus grande tolérance, un contexte plus favorable, etc.
En bref, j’ai moi-même commencé ma recherche avec mon paquet de clichés sur les Français habitant sur le Plateau, avec plein de cash et la peau plus blanche que neige, mais finalement, c’est bien plus complexe que ça.
Je pense notamment à la condition féminine et au sexisme. La totalité des participantes à la recherche ont exprimé qu’elles n’ont pas nécessairement quitté la France à cause du sexisme, ce n’était pas une raison de partir, mais c’est devenu une raison de rester. Ces femmes ont réalisé à quel point elles subissaient le harcèlement public, le sentiment d’insécurité, des inégalités dans différentes sphères de leurs vies et des enjeux de violences sexuelles. Loin de moi l’idée de conclure que le Québec est moins sexiste ou moins patriarcal, ce n’est pas mon rôle, mais plutôt d’amplifier la voix et l’expérience de ces participantes pour qui la migration a été le moment d’une prise de conscience féministe. Elles disent se sentir en sécurité au Québec, relèvent la possibilité de s’habiller comme elles le désirent, par exemple, sans se faire insulter dans la rue, et on voit alors que les logiques d’établissement ne sont pas les mêmes selon le genre.
Pour les conditions des personnes racisées, c’est plus nuancé. Il y a aussi un rejet du contexte politique français, de l’extrême-droite, du racisme ordinaire. Des participants parlent du fait qu’en France, on les traitait différemment ou faisaient l’expérience de micro-agressions au quotidien. Par contre, au Québec, ce n’est pas une expérience exempte de violence ou de difficultés pour les personnes racisées. Un participant m’a dit, par exemple, avoir découvert « le fait d’être noir » au Québec. En France, on se veut universaliste, on dit plutôt « mais non, t’exagères, le serveur ne t’a pas mal parlé parce que t’es black, on ne voit pas la couleur ». Finalement, c’est quelque chose qui est tellement récurrent dans leur vie, ils réalisent en venant ici qu’ils ont maintenant plus de mots pour en parler.
Ces personnes racisées, notamment d’origine africaine, antillaise ou asiatique, se sont senties enfin validées dans leur identité française… une fois qu’elles ne sont plus en France ! En France, on leur demande toujours « D’où tu viens ? », « Tes parents viennent d’où ? », « Est-ce que t’es né ici ? ». Au Québec, on va plutôt dire, « J’entends ton accent, d’où tu viens ? De la France ? Ok ». Des participants m’ont confié enfin se sentir français et fier de l’être en étant, paradoxalement, loin de la France. C’est une redécouverte de l’identité française.
Sur les enjeux LGBTQ+, moins de personnes de mon échantillon s’y identifiaient donc je ne peux pas généraliser, mais il y a des personnes qui ont dit avoir eu plus de facilités à se dire faire partie de la communauté LGBTQ+ ou de la communauté queer. Plusieurs ont constaté qu’au Québec, il y aurait une plus grande tolérance, un contexte plus favorable, etc.
En bref, j’ai moi-même commencé ma recherche avec mon paquet de clichés sur les Français habitant sur le Plateau, avec plein de cash et la peau plus blanche que neige, mais finalement, c’est bien plus complexe que ça.
pvtistes
De tes recherches, tu as établi 4 types de trajectoire migratoire de Français au Québec, peux-tu nous en dire plus ?
Bien sûr, voici ceux que j’ai relevé :

- L’ancrage permanent : on parle ici de Français d’origine, très attachés au Québec, dont l’intégration relationnelle et culturelle est très forte. On y retrouve plusieurs couples mixtes franco-québécois. Ces personnes font l’expérience d’un certain rejet de la France et de ses structures, mais pas nécessairement de leur identité ou de leur accent. Elles négocient cette identité hybride avec des groupes d’amis et des milieux de travail très mixtes, et il y a une grande part de développement personnel et d’émancipation. L’insertion juridique et économique est assez bonne mais pas surdéterminante par rapport à la culture et aux relations. D’ailleurs, on retrouve dans ce type beaucoup de difficultés, de frustrations et de stress liés à la difficile accession à la résidence permanente et à la citoyenneté.
- Les allers-retours ou les migrations pendulaires : ce sont des personnes qui ont surtout une intégration structurelle avec un bon revenu, un bon emploi, pas de difficultés administratives, ou encore de l’argent pour se payer des bons avocats pour décrocher éventuellement une résidence permanente. Paradoxalement, cette résidence permanente va favoriser la mobilité entre la France et le Québec. Ils vont favoriser le télétravail ou des vacances, un congé sabbatique, qui peuvent permettre une vie en alternance, peut-être au gré des saisons, entre la France et le Québec. Ici, la France n’est pas rejetée, ou du moins pas complètement, et des réticences persistent face à la société québécoise. À noter, aussi, que l’intégration culturelle et relationnelle est moindre, il y a moins de réseaux mixtes, moins de conjugalité mixte, peut-être une certaine méconnaissance de la culture ou des normes sociales.
- Seule la sécurité, ou la mobilité selon les conditions d’existence : ce sont des personnes pour qui l’identité politique ou les conditions d’existence vont primer sur le spectre France-Québec. Il ne s’agit pas juste de l’attraction du Québec et de la répulsion de la France. C’est surtout une appréciation de type « est-ce que je peux vivre ma religion, ma couleur, mon identité de genre », ou juste « qui je suis, mon identité » peu importe laquelle. Certains m’ont dit que si les conflits politiques français étaient reproduits au Québec, ils ou elles n’hésiteraient pas à bouger ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Ici, la migration ne tient pas à l’attachement au Québec, mais à la répulsion d’un contexte politique, de certaines valeurs. Pour ces personnes, le projet est indéfini et la mobilité en tant que telle a une réelle valeur.
- Retour en France : c’est l’angle mort de ma recherche, puisque je n’ai interrogé que des personnes qui sont restées.

pvtistes
Tu as également travaillé sur les couples mixtes (franco-québécois), qu’est-ce que tu en ressors ?
J’ai fait un article très préliminaire sur le sujet, j’avais interviewé seulement 3 Français en couple hétérosexuel avec des Québécoises. De manière générale, il y a des chocs culturels dans cette conjugalité, notamment dans les étapes avant la mise en relation.
Il y a cette fameuse phase du dating ou de fréquentation qui est typiquement nord-américaine et qui est moins connue des Français, qui se sont heurtés à « Mais c’est ma copine, mon copain, ou non ? ». Pour les Français, lorsqu’il y a des rapprochements intimes, qu’on a des relations sexuelles, cela voudrait généralement dire être en couple alors qu’au Québec, cette phase de dating n’est pas exclusive et ça peut créer des confusions.
Dans la gestion des conflits, il y a de grosses différences culturelles, que ce soit dans le couple ou dans la culture du travail d’ailleurs. La communication et la gestion des conflits est beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe de la part des Français. Au Québec, on pourrait dire péjorativement que c’est un peu plus hypocrite, ou positivement que c’est plus délicat, plus enrobé. Un Québécois va dire « J’entends ce que tu dis, mais pourquoi on ferait pas telle ou telle chose à la place ? », quand un Français va dire « Mais t’es con ou quoi ? ». Dans les deux cas, ça peut fonctionner, mais avec les forces et les faiblesses de chaque modèle.
Pour continuer sur les relations franco-québécoises, il y a une métaphore qu’une participante m’a partagée sur l’image de la noix de coco et de l’avocat. Les Français seraient des noix de coco, c’est-à-dire une coquille assez dure, pour la percer, il faut le vouloir. Les Français ont l’image d’être plus froids et distants au début, mais à la seconde où la coquille est percée, on tombe très rapidement dans le doux. C’est tellement bon une noix de coco, il n’y a pas d’autres couches : tu perces la coquille de quelqu’un en soirée, ça peut être ton meilleur ami le lendemain matin. Au Québec, la coquille est beaucoup plus friable, la barrière est moins présente, comme un avocat. Parfois, tu appuies avec tes doigts et boum, t’es déjà dans le vert. C’est plus facile à manger qu’une noix de coco, mais il y a toujours un noyau plus ou moins grand auquel on va forcément finir par se heurter. Ce noyau peut être les relations déjà établies : tu peux rencontrer un Québécois avec qui tu t’entends super bien, mais il a déjà ses meilleurs amis, sa famille et pas une seconde de disponible. Ce ne sont pas les mêmes manières de rester en relation, ni d’y rester.
Il y a cette fameuse phase du dating ou de fréquentation qui est typiquement nord-américaine et qui est moins connue des Français, qui se sont heurtés à « Mais c’est ma copine, mon copain, ou non ? ». Pour les Français, lorsqu’il y a des rapprochements intimes, qu’on a des relations sexuelles, cela voudrait généralement dire être en couple alors qu’au Québec, cette phase de dating n’est pas exclusive et ça peut créer des confusions.
Dans la gestion des conflits, il y a de grosses différences culturelles, que ce soit dans le couple ou dans la culture du travail d’ailleurs. La communication et la gestion des conflits est beaucoup plus frontale, beaucoup plus directe de la part des Français. Au Québec, on pourrait dire péjorativement que c’est un peu plus hypocrite, ou positivement que c’est plus délicat, plus enrobé. Un Québécois va dire « J’entends ce que tu dis, mais pourquoi on ferait pas telle ou telle chose à la place ? », quand un Français va dire « Mais t’es con ou quoi ? ». Dans les deux cas, ça peut fonctionner, mais avec les forces et les faiblesses de chaque modèle.
Pour continuer sur les relations franco-québécoises, il y a une métaphore qu’une participante m’a partagée sur l’image de la noix de coco et de l’avocat. Les Français seraient des noix de coco, c’est-à-dire une coquille assez dure, pour la percer, il faut le vouloir. Les Français ont l’image d’être plus froids et distants au début, mais à la seconde où la coquille est percée, on tombe très rapidement dans le doux. C’est tellement bon une noix de coco, il n’y a pas d’autres couches : tu perces la coquille de quelqu’un en soirée, ça peut être ton meilleur ami le lendemain matin. Au Québec, la coquille est beaucoup plus friable, la barrière est moins présente, comme un avocat. Parfois, tu appuies avec tes doigts et boum, t’es déjà dans le vert. C’est plus facile à manger qu’une noix de coco, mais il y a toujours un noyau plus ou moins grand auquel on va forcément finir par se heurter. Ce noyau peut être les relations déjà établies : tu peux rencontrer un Québécois avec qui tu t’entends super bien, mais il a déjà ses meilleurs amis, sa famille et pas une seconde de disponible. Ce ne sont pas les mêmes manières de rester en relation, ni d’y rester.
pvtistes
Tu as la double nationalité et tu as vécu aussi bien en France qu’au Canada. Quelles sont les plus grandes différences pour toi entre ces deux pays ?
J’enlève le chapeau de sociologue pour partager des expériences plus personnelles. J’ai en effet eu à choisir à l’âge de 15 ans où vivre, après avoir vécu entre les deux pays en garde partagée (environ 6 mois, 6 mois).
J’ai connu les deux systèmes scolaires, les deux sociétés. Je parle surtout des deux villes que je connais, Montréal et Lille. J’aime beaucoup Lille, mais j’ai pourtant choisi de vivre au Québec. Je me sentais plus étouffé en France. Je trouvais que la société, que ce soit le système scolaire, dans la rue, à la mairie, etc., tout semblait très figé, très sclérosé. J’avais une impression générale de “gris”, sans pour autant dire que tout est rose au Québec, bien sûr. Au Québec, j’avais le privilège d’être dans une très bonne école alors qu’en France j’avais connu un contexte plus violent. Je me suis senti plus détendu au Québec, dans ce contexte d’appréciation, de tolérance, de simplicité.
J’ai voulu confirmer mon choix en allant faire un échange universitaire à Lille. J’ai adoré cette ville comme jeune adulte, c’est tellement beau, c’est grand, il y a de beaux commerces, des bars, des musées, etc. Mais… c’était assez après 5 mois. J’ai vu plus de conflits en 5 mois en France qu’en 5 ans au Québec. Je ne veux pas du tout invalider l’amour de la France ou le fait d’être bien dans cette société : c’est une expérience très personnelle, que ce soit pour moi ou les personnes que j’ai interrogées. La France n’est pas une société à rejeter et le Québec une société à adopter. ll faut juste être à l’endroit qui correspond à ce qu’on est.
Cela dit, ça fait bientôt trois ans que je n’ai pas été en France à cause de la pandémie et je n’en peux plus. J’ai tellement hâte de prendre un verre avec mes amis à Lille. J’ai toujours énormément d’amour pour la France.
J’ai connu les deux systèmes scolaires, les deux sociétés. Je parle surtout des deux villes que je connais, Montréal et Lille. J’aime beaucoup Lille, mais j’ai pourtant choisi de vivre au Québec. Je me sentais plus étouffé en France. Je trouvais que la société, que ce soit le système scolaire, dans la rue, à la mairie, etc., tout semblait très figé, très sclérosé. J’avais une impression générale de “gris”, sans pour autant dire que tout est rose au Québec, bien sûr. Au Québec, j’avais le privilège d’être dans une très bonne école alors qu’en France j’avais connu un contexte plus violent. Je me suis senti plus détendu au Québec, dans ce contexte d’appréciation, de tolérance, de simplicité.
J’ai voulu confirmer mon choix en allant faire un échange universitaire à Lille. J’ai adoré cette ville comme jeune adulte, c’est tellement beau, c’est grand, il y a de beaux commerces, des bars, des musées, etc. Mais… c’était assez après 5 mois. J’ai vu plus de conflits en 5 mois en France qu’en 5 ans au Québec. Je ne veux pas du tout invalider l’amour de la France ou le fait d’être bien dans cette société : c’est une expérience très personnelle, que ce soit pour moi ou les personnes que j’ai interrogées. La France n’est pas une société à rejeter et le Québec une société à adopter. ll faut juste être à l’endroit qui correspond à ce qu’on est.
Cela dit, ça fait bientôt trois ans que je n’ai pas été en France à cause de la pandémie et je n’en peux plus. J’ai tellement hâte de prendre un verre avec mes amis à Lille. J’ai toujours énormément d’amour pour la France.

pvtistes
Quels conseils donnerais-tu à un Français ou un étranger de manière générale pour bien s’intégrer au Canada, plus particulièrement au Québec ?
Il n’y a pas de recette miracle, mais je pense à quelques points en particulier :
- En raison de la proximité culturelle (réelle ou imaginée) entre les deux pays, on pense que ça va nécessairement être facile. Au final, on est tellement proches culturellement par rapport à d’autres pays qu’on ne s’attend pas aux difficultés, qui sont pourtant totalement normales lors d’une migration, sur les plans culturels, professionnels, administratifs, etc. Les difficultés, si on s’y attend, ça va les minimiser, alors que si on s’attend à ce que ce soit simple, les difficultés vont vraiment heurter.
- J’invite à l’ouverture mutuelle. Il y a ce cliché des Français qui restent entre Français, et c’est tout à fait louable si c’est l’objectif. Cependant, j’ai remarqué lors de mes entretiens que ceux qui restaient de manière permanente avaient un ancrage très fort avec les Québécois au niveau des relations amicales. Essayez d’aller vers cette mixité pour apprécier totalement la culture.
- Il ne faut pas être dans la comparaison. S’ennuyer de la France est une chose, comparer et critiquer en est une autre. Moi-même, vivant au Québec 23 mois sur 24, je m’ennuie de certains fromages, de certains pains, de certaines ambiances, de bars, de mes amis et de ma famille. Ce qu’il y a en France et ce qu’il n’y a pas au Québec sont deux enjeux totalement différents. Moins aimer le Québec pour ce qu’il n’a pas par rapport à la France, c’est un pas que je ne suis pas prêt à franchir. Il faut y réfléchir avant la migration.
pvtistes
Pour finir, quels sont tes projets ?
Il faut déjà que je finalise ce mémoire qui sera disponible sur le site de l’Université de Montréal dans quelques mois. J’aimerais pourquoi pas poursuivre sur une enquête sur les Français qui sont partis ou explorer davantage les enjeux de conjugalité mixte. Des recherches récentes ont d’ailleurs été effectuées sur ces sujets, notamment Noé Klein (2019) sur les dynamiques relationnelles franco-québécoises et Ines Sanchez (2020) sur les mobilités étudiantes françaises à Montréal.
Sur un plan plus personnel, j’aime beaucoup lire, j’adore la littérature québécoise (je vous invite à en lire !). J’aimerais peut-être un jour écrire sur mon histoire personnelle, sur ma trajectoire entre deux pays sous forme plus romanesque que scientifique. Ce serait un petit rêve !
Sur un plan plus personnel, j’aime beaucoup lire, j’adore la littérature québécoise (je vous invite à en lire !). J’aimerais peut-être un jour écrire sur mon histoire personnelle, sur ma trajectoire entre deux pays sous forme plus romanesque que scientifique. Ce serait un petit rêve !





















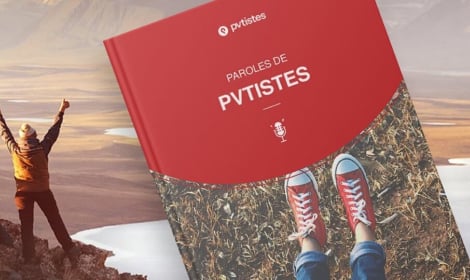











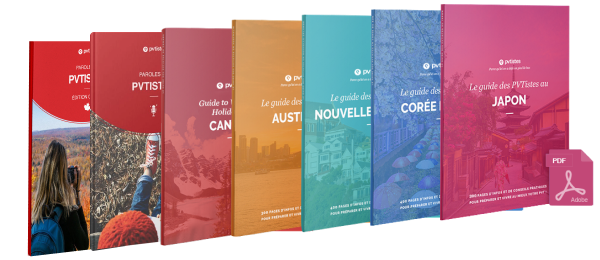




(2) Commentaires
Très intéressant ce que vous dites, je crois que je vais relire une deuxième fois.
Merci.
Merci pour vos bons mots, c’est fort apprécié. Si vous souhaitez discuter davantage, n’hésitez pas à m’écrire !
{{like.username}}
Chargement...
Voir plus